Pourquoi les pyramides d’Égypte, les temples grecs, certaines œuvres de Léonard de Vinci, les spirales des tournesols et même la structure de notre ADN semblent ils obéir à la même proportion mystérieuse ?
Cette proportion, connue sous le nom de nombre d’or — notée φ (phi) — fascine les mathématiciens, les artistes et les scientifiques depuis des siècles. Elle est synonyme d’harmonie, d’équilibre et de beauté.
Le nombre d’or est une valeur mathématique irrationnelle, c’est-à-dire qu’il ne peut pas s’écrire sous forme de fraction exacte. Sa valeur approchée est 1,6180339….
Son histoire remonte à la Grèce antique. Euclide en décrit les propriétés géométriques dès le IIIe siècle av. J.-C., et Pythagore lui attribue une dimension presque mystique.
À la Renaissance, Léonard de Vinci l’illustre dans ses dessins, notamment dans le célèbre Homme de Vitruve, tandis que le mathématicien Luca Pacioli le surnomme « la divine proportion ». Réalisé vers 1490 par Léonard de Vinci, L’Homme de Vitruve est bien plus qu’un simple dessin anatomique. Inspiré des écrits de l’architecte romain Vitruve, il illustre les proportions idéales du corps humain inscrites à la fois dans un carré et un cercle, symboles de la terre et du ciel. De Vinci y a appliqué ses recherches sur la “divine proportion” : la distance du sommet de la tête au nombril par rapport à la hauteur totale, ou encore la proportion entre certaines parties du visage, se rapprochent du nombre d’or φ. Cette superposition de mathématiques, d’art et d’anatomie incarne parfaitement la vision de la Renaissance, où l’homme était perçu comme reflet miniature de l’ordre harmonieux de l’univers. Léonard de Vinci et les architectes de la Renaissance utilisaient donc ces proportions pour équilibrer leurs œuvres.
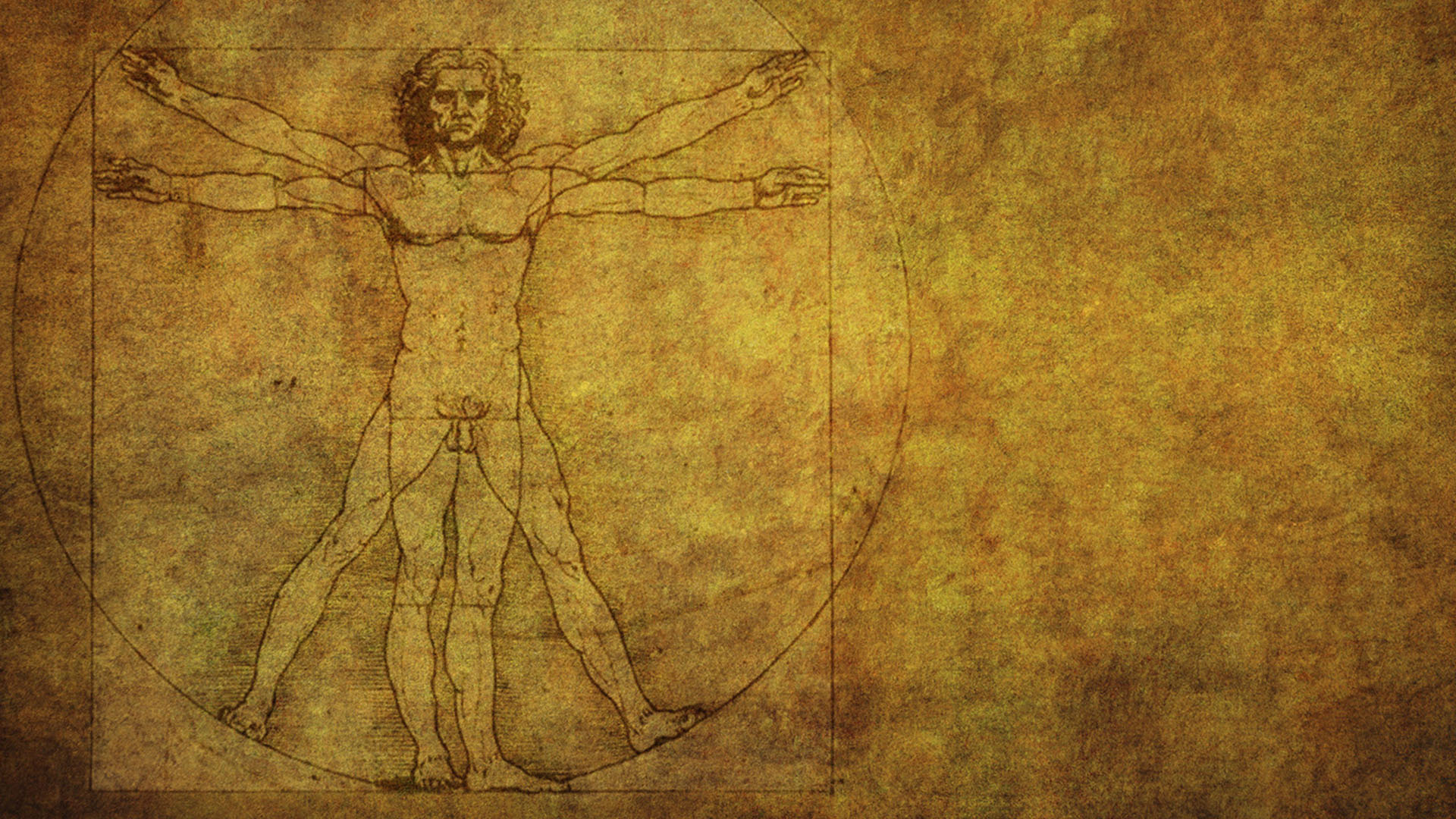
Depuis l’Antiquité, de nombreuses œuvres architecturales sont associées au nombre d’or.
Le Parthénon à Athènes présente des rapports de hauteur et de largeur qui rappelleraient φ.
La grande pyramide de Khéops est une structure à base carrée, haute à l’origine d’environ 146,6 m pour un côté de base d’environ 230,4 m.
Lorsque l’on trace certaines lignes dans sa section, on obtient des proportions qui se rapprochent du nombre d’or φ. On ne sait pas si c’était intentionnel pour refléter un savoir mathématique avancé, lié à l’harmonie et aux cycles cosmiques ou le résultat d’autres choix architecturaux (stabilité, symbolisme solaire).
Cette proportion se retrouve aussi dans la nature. Les graines d’un tournesol ou les écailles d’une pomme de pin s’organisent selon des spirales dont le nombre de bras correspond à des termes de la suite de Fibonacci, intimement liée à φ.
La coquille du nautile et celle de certains mollusques se développent en spirales logarithmiques proches de la proportion dorée.
Chez l’homme, plusieurs mesures corporelles — comme la distance du nombril à la tête par rapport à la taille totale — se rapprochent de φ. Les proportions du visage humain sont aussi souvent analysées à travers ce prisme.
A l’échelle microscopique, la double hélice de l’ADN, molécule clé du vivant, présente des proportions étonnamment proches du nombre d’or : un tour d’hélice mesure environ 3,4 nm de haut pour 2,0 nm de large, soit un rapport proche de 1,618. Cela illustre combien cette proportion apparaît souvent dans des structures optimisées par l’évolution.
Enfin, les bras spiraux de certaines galaxies suivent des courbes apparentées à la spirale dorée.
De la géométrie antique aux spirales des galaxies, du Parthénon aux algorithmes de design modernes, le nombre d’or illustre le dialogue subtil entre mathématiques, art et nature.
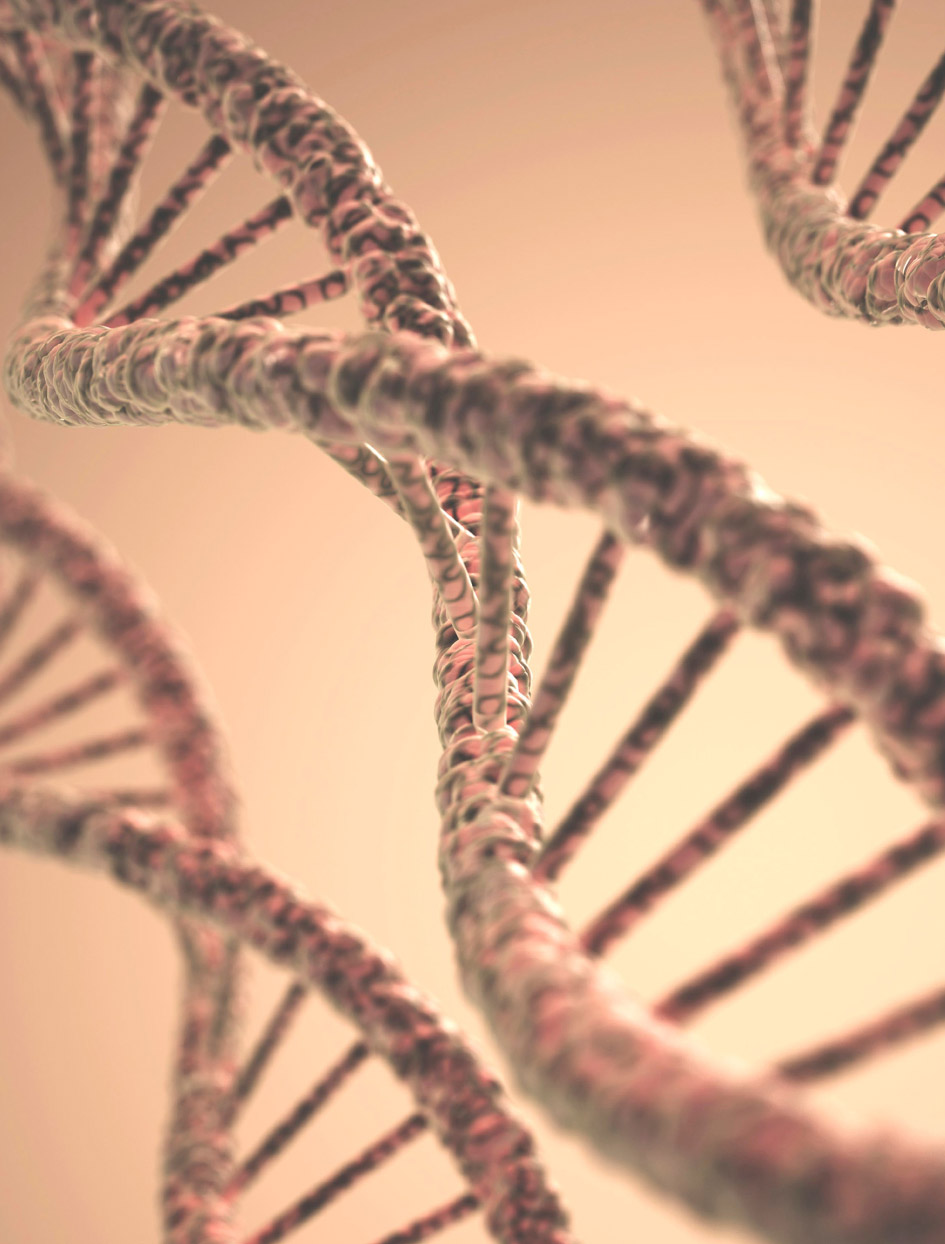
Il est un symbole puissant de la quête humaine pour comprendre et reproduire l’harmonie du monde.



